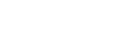Benoît Bayle

Benoît Bayle, Le trophée !
dimanche 25 juillet 2010

Benoît Bayle, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la psychologie de la conception humaine et de la périnatalité, est psychiatre des hôpitaux et docteur en philosophie. Il exerce comme praticien hospitalier au Centre hospitalier Henri Ey de Bonneval. Il a reçu le Trophée 2010 de l'enseignement et de la recherche en éthique - Prix coup de coeur 2010 de l'Ajmed.
“Voilà un fait de marque pour signaler qu'un docteur qui est des nôtres a bien réussi... DF”
Il nous communique l’allocution présentée à cette occasion :
TROPHÉES 2010 DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE EN ÉTHIQUE
Qu'il me soit permis, pour commencer, d'exprimer toute ma gratitude aux membres du jury et aux différents organisateurs de ces trophées. C'est avec beaucoup de reconnaissance que j'accueille ces Trophées 2010 de la recherche en éthique.
Quelles ont été les grandes lignes de cette recherche entreprise depuis 1996 ?
À l'origine, je m'intéressais aux problèmes éthiques posés par les procréations artificielles. Comme psychiatre, il m’était impossible de négliger l’éventuel impact psychologique de ces pratiques, en particulier à l'égard des enfants conçus par ces méthodes. L'idée de départ a donc été la suivante : « Si nous voulons comprendre les implications psychologiques des procréations artificielles, afin d'en discuter certains aspects éthiques, il nous faut d'abord comprendre la psychologie de la conception naturelle ! » J'ai alors choisi de m'orienter vers une étude psychopathologique de la conception humaine, ce qui revient à repérer l'émergence de problématiques psychopathologiques dès la conception d'un enfant.
J'ai étudié la question de l'enfant de remplacement, conçu pour remplacer un enfant mort ; la conception après viol ou inceste ; la survivance conceptionnelle et prénatale, c'est-à-dire le fait, pour un embryon ou un foetus, d'appartenir à un groupe de pairs décimé ; le déni de grossesse, qui passe par un déni de conception ; la conception de l'enfant chez les parents malades mentaux ; l'enfant issu des procréations artificielles.
Quelles ont été les résultats de ces recherches ?
Il est bien entendu impossible de rentrer dans le détail de ces études psychopathologiques. Celles-ci m’ont permis d'envisager la grossesse comme une période du développement mental de l'être humain. J'ai pu également appréhender la nature de l'embryon humain et définir des atteintes à la dignité de l’être humain conçu.
En effet, tout être humain conçu possède une identité conceptionnelle, qui répond aux questions : « qui suis-je ? », « d’où est-ce que je viens ? ». Mon propre corps me pose ces questions fondamentales : « quel est mon être ? », « à qui dois-je la vie ? », etc. Seul autrui peut m’apprendre alors qui je suis, ou bien, me tromper sur ma propre identité. En fait, avant d’être « fils ou fille de … », nous sommes « être conçu de tel homme et de telle femme, à tel moment de l’histoire de l’humanité, et en tel lieu du monde». L’identité conceptionnelle donne une subjectivité à notre propre corps. Je ne peux me poser la question « qui suis-je ? » sans découvrir autrui en moi-même : j’ai une dette à l’égard d’autrui. Autrui m’apparaît à l’intérieur de moi-même, autrui se reflète en moi. Je ne peux m’interroger sur moi-même, sans me tourner vers l’histoire d’une rencontre interpersonnelle qui fonde, parfois avec ses aléas, mon existence. En ce sens, l’être humain conçu possède une véritable structure intersubjective. Il est ontologiquement, dans son être, en relation avec autrui à l’intérieur de lui-même.
Si je cherche maintenant à comprendre ce qu’est un embryon humain, je ne peux pas me contenter de le définir comme un matériau biologique, comme un zygote qui a une identité génétique, avec des chromosomes, de l’ADN, etc. – ce qui est pourtant déjà énorme ! Cet embryon est le fruit d’une rencontre, il est le fruit de deux histoires humaines singulières et il a sa biographie propre, son histoire. Il est, dès sa conception, « être humain conçu à tel moment de l'histoire, en tel lieu du monde, issu de tel homme et de telle femme, qui ont chacun telle histoire, telle psychologie, telle appartenance sociale, telle culture, qui appartiennent chacun à telle famille élargie avec sa structure généalogique particulière, qui ont reçu chacun tel nom par leur filiation instituée, et qui se trouvent unis l'un à l'autre par telle relation psychoaffective »… De ces différentes déterminations dépend l'identité même de l'être humain conçu. L'être humain conçu incarne en son corps biologique ces déterminations psychosocioculturelles en une unité originale, qui fonde ce qu'il est, sans le confondre avec ceux qui lui donnent vie. L'être humain conçu est d'emblée un être biopsychique. Cette identité originelle, que j’appelle l’identité conceptionnelle, trouve sa place dans le développement de la personnalité et participe à la construction du sentiment d'identité de l'être humain. La repérer a des implications cliniques dans la pratique psychothérapeutique.
Cette notion intéresse également le champ bioéthique : par exemple, la structure de l’identité conceptionnelle se trouve radicalement bouleversée par les méthodes de procréation artificielle. Le sujet voit désormais sa dette de vie circonscrite dans la sphère publique.
Il nous faut ainsi élargir cette approche au débat de société.
La possibilité de traiter l'embryon humain comme une « presque chose » constitue la pierre angulaire de la maîtrise de la procréation, tant la société postmoderne ne parvient à s'affranchir d'une logique de surproduction, de sélection et de surconsommation des embryons et des foetus humains.
Par exemple, l'usage du stérilet provoque, selon toute vraisemblance, la destruction de plusieurs millions d'embryons humains chaque année, en France. Les fécondations in vitro entraînent un important gaspillage embryonnaire : seulement 3 % à 5 % des embryons donneront naissance à un enfant. Depuis la légalisation de l'interruption de grossesse, près de 7 millions d'interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été réalisées, ce qui aurait représenté, si elles n'avaient pas eu lieu, la naissance de près de 4 à 5 millions d'enfants dit « non-désirés ». Avec l’interruption médicale de grossesse (IMG), on assiste à l'extinction progressive d'une population génétiquement discriminée, de plus en plus efficacement repérée : celle des sujets porteurs de trisomies 21.
Cette instrumentalisation de l’être humain prénatal a un impact sur la psychologie individuelle et collective des vivants…
Que penser par exemple de ces nouvelles biographies prénatales ? Dix embryons sont conçus in vitro ; trois sont transférés à l’état frais, mais ne se développent pas ; quatre sont éliminés, car ils ne sont pas assez « beaux » ; trois sont congelés, puis transférés après décongélation ; un seul vivra, investi par ses parents comme un être à part, exceptionnel, qui a survécu aux autres. Ou encore : deux premières grossesses sont interrompues, car le père et la mère estiment que « ce n'est pas le moment » ; un premier enfant vivant naît, désiré par ses deux parents, puis un deuxième, pour lequel le père a souhaité l'interruption de grossesse, mais auquel la mère a voulu donner vie ; je recevrai cet enfant pour des troubles du sommeil...
Le modèle psychopathologique de la survivance peut s'appliquer à ces situations. Je l'ai décrit pour ma part sur une petite population de cas. Nous observons la même configuration que dans le cadre de la survivance de l'adulte, avec une problématique psychopathologique en trois dimensions : culpabilité (« est-ce que je mérite de vivre alors que les autres sont
morts ? ») ; toute-puissance (« je suis plus fort que les autres, j'ai vaincu la mort ! » ; épreuve de la survie, expression paradoxale des mouvements de culpabilité et de toute-puissance (prise de risque, maladie psychosomatique).
En réalité, le féminisme semble nous avoir libérés, en partie au moins, du rapport de domination homme-femme. Cependant, la révolution procréatique nous a fait glisser vers un autre rapport de domination, qui passe volontiers inaperçu : il s'agit du rapport de domination de l'homme et de la femme sur l'enfant à naître.
Ne faut-il pas penser alors la question de la dignité de l'être humain conçu ?
La psychopathologie de la conception humaine montre l'existence d'atteintes à la dignité, dès la conception de l'être humain. Il s'agit du cas de l'enfant issu du viol ou de l’inceste. Être conçu d'un viol constitue une atteinte à la dignité humaine, et cette atteinte, qui touche à l'identité même de la personne, apparaît dès la conception.
Nous pouvons entrevoir d'autres atteintes à la dignité de l'enfant à naître, intéressant la période prénatale, cette fois sur le versant physique. La prescription du distilbène représente par exemple une authentique atteinte à la dignité humaine des enfants à naître de sexe féminin, qui plus tard ont été exposé à l'infertilité, au cancer du vagin, ou à d'autres malformations...
Ces observations tendent à fonder, en raison, un droit objectif à l'intégrité de l'être humain conçu…
Cependant, la société est-elle en mesure d'accepter une telle analyse ? Ne doit-elle pas prendre conscience du projet utopique qui nourrit la révolution procréatique ? Celle-ci repose sur des dogmes contestables qui méritent une lecture critique. Par exemple, la notion d'enfant désiré doit être remise en cause tant elle favorise, couplée à la pratique de l'interruption de grossesse, une catégorisation des êtres humains difficilement acceptable au plan éthique entre, d’une part, les enfants désirés qui mérite d’être accueillis, et d’autre part, les enfants non-désirés, qui peuvent (sinon qui doivent) être éliminés...
Loin de moi l’idée d’un retour au passé, en rien idéalisable ! La révolution procréatique s'est construite sur le terreau de réalités humaines douloureuses qu'elle a voulu prendre en compte à juste titre : oppression sociale de la femme, misère des familles nombreuses, grossesses difficiles, enfants rejetés, etc. Cependant, elle l'a fait en instrumentalisant l'enfant à naître, et cette instrumentalisation pourrait nous réserver des lendemains qui déchantent, car elle constitue une authentique forme de violence sociale. Il nous appartient d’en mesurer les effets et de saisir notre avenir. Une troisième voie est possible, à condition que chacun s'y engage, et accepte d'entrevoir que l'homme, la femme et l'enfant à naître ne sauraient représenter des entités exclusivement conflictuelles.
Quelles ont été, pour finir, les réalisations concrètes de cette recherche ?
Vous l’aurez compris, ces recherches entreprises dans le cadre de ma thèse de philosophie, à l’Université de Marne-la-Vallée, m’ont permis d’explorer un nouveau champs clinique : la psychopathologie de la conception humaine, qui est enseignée dans plusieurs diplômes d’université.
Dans le cadre de ma pratique de psychiatre, j’ai été amené à ouvrir une consultation de psychiatrie périnatale, puis une unité de psychologie périnatale.
Enfin, j’ai publié plusieurs livres sur ces sujets, afin de faire connaître ces problématiques dans les milieux professionnels concernés, et afin de participer au débat bioéthique. J’espère que ces connaissances contribueront à améliorer les soins à la fois des femmes enceintes, mais aussi des personnes souffrant de psychopathologies conceptionnelles...
J’espère aussi que cette réflexion aidera la société à prendre conscience de certains enjeux méconnus de la médecine de la procréation. Je vous remercie. Benoît Bayle
Madame, Monsieur,
C'est avec plaisir que je me permets de vous annoncer que j'ai reçu récemment le Trophée 2010 pour la recherche en éthique, décerné par la Fondation Ostad Elahi sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (partenariat avec le CNAM, l'ORS, le CERSES et la revue Sciences humaines)...
http://www.fondationostadelahi.fr/front_content.php?idcat=173
Ce prix m'a été remis le 17 juin par le Pr. Didier Sicard, ancien président du Comité Consultatif National d'Ethique.
J'avais présenté les travaux entrepris depuis 1996 autour du thème "Ethique, psychologie et médecine de la procréation", et plus particulièrement mon dernier ouvrage "A la poursuite de l'enfant parfait. L'avenir de la procréation humaine" (Robert Laffont, 2009).
Cet ouvrage a également reçu cette année le prix "coup de coeur" 2010 de l'Association des journalistes médicaux grand public.
http://www.ajmed.fr/227/Prix-litteraire-2010.html
Dr. Benoît Bayle, MD, PhD - Chartres (France)
E-mail : benoit.bayle@orange.fr